Souveraineté numérique : quand les infrastructures américaines deviennent des armes géopolitiques
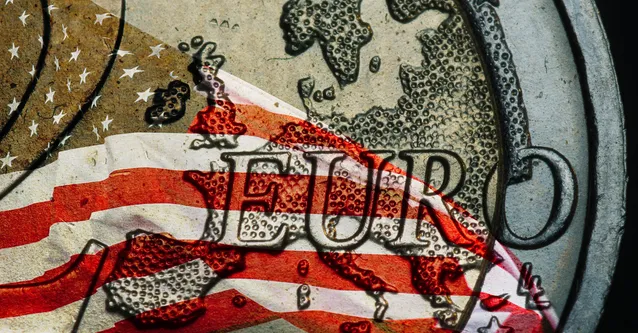
En octobre 2025, Nicolas Guillou, juge français à la CPI, a vu ses comptes Amazon, Airbnb et PayPal suspendus sans préavis suite aux sanctions américaines. Quelques mois plus tôt, en mai 2025, cinq membres de la Cour Pénale Internationale ont subi le même sort avec leurs accès Microsoft coupés. Ces incidents, apparemment isolés, révèlent une réalité préoccupante : les infrastructures numériques dominées par les États-Unis servent d’outils de politique étrangère.
Pour les entreprises européennes, cette dépendance technologique représente un risque stratégique majeur. La suspension d’accès aux services cloud, aux systèmes de paiement ou aux plateformes essentielles peut paralyser les activités en quelques heures, sans recours possible.
Les infrastructures américaines au cœur de notre quotidien numérique
La domination technologique américaine ne s’est pas construite par hasard. Elle résulte de décennies d’investissements massifs dans l’innovation et d’une stratégie délibérée de contrôle des infrastructures critiques.
Une concentration du pouvoir technologique
Les GAFAM (Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft) contrôlent aujourd’hui l’essentiel de l’écosystème numérique mondial. Microsoft domine le marché des systèmes d’exploitation professionnels et des solutions cloud avec Azure, Google contrôle 92% des recherches en ligne et détient Android, Amazon Web Services représente 32% du marché mondial du cloud computing, tandis qu’Apple impose ses standards via iOS et son écosystème fermé.
Cette concentration s’étend aux infrastructures financières. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), bien que basé en Belgique, opère sous forte influence américaine. Les États-Unis exercent un contrôle indirect via leur réglementation extraterritoriale, les systèmes de paiement (Visa, Mastercard, PayPal) sont majoritairement américains, et le dollar est impliqué dans 88% des transactions de change mondiales et représente 50% des paiements internationaux via SWIFT.
Les leviers juridiques du contrôle
Plusieurs législations américaines permettent d’exercer une pression directe sur les entreprises technologiques, même en dehors du territoire américain.
Le CLOUD Act (2018) autorise les autorités américaines à accéder aux données stockées par les entreprises US, peu importe leur localisation géographique. L’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) permet au président américain de bloquer des transactions et de geler des actifs en cas de “menace inhabituelle”. Les Export Administration Regulations (EAR) contrôlent l’exportation de technologies américaines, y compris les logiciels.
Cette architecture juridique transforme chaque entreprise technologique américaine en potentiel exécutant des politiques étrangères de Washington.
Cinq cas révélateurs de dépendance technologique
Les incidents de 2025 ne constituent pas des anomalies. Ils s’inscrivent dans un schéma établi d’utilisation des infrastructures numériques comme instruments de coercition.
1. La Cour Pénale Internationale privée de ses outils
En mai 2025, Microsoft a suspendu l’accès de cinq membres de la CPI à ses services cloud, probablement suite à des pressions américaines liées aux enquêtes sur des responsables israéliens. Cette action fait écho aux menaces américaines contre la CPI documentées depuis 2018-2020, lorsque l’administration Trump avait menacé des juges enquêtant sur d’éventuels crimes de guerre en Afghanistan.
Impact concret : La CPI, institution de justice internationale, s’est retrouvée privée d’accès à ses propres documents de travail, démontrant la vulnérabilité des organisations internationales face aux décisions unilatérales des fournisseurs technologiques.
2. Huawei coupé de l’écosystème Android
En mai 2019, Google a révoqué la licence Android de Huawei sur ordre du Département du Commerce américain, dans le cadre de la guerre technologique sino-américaine. Cette décision a contraint Huawei à développer son propre système d’exploitation, HarmonyOS, un processus long et coûteux.
Leçon stratégique : Une entreprise, même parmi les leaders mondiaux (Huawei était le 2ème fabricant de smartphones), peut se voir privée d’accès à une technologie essentielle du jour au lendemain. La dépendance aux écosystèmes propriétaires représente un risque existentiel.
3. Les banques russes exclues de SWIFT
En février 2022, suite à l’invasion de l’Ukraine, plusieurs banques russes ont été exclues du réseau SWIFT. Cette mesure, prolongée en 2025, a profondément perturbé les paiements internationaux de la Russie et contraint le pays à développer son propre système, SPFS (System for Transfer of Financial Messages).
Impact économique : L’exclusion de SWIFT équivaut à une excommunication financière. Les entreprises russes ont vu leurs capacités d’import-export drastiquement réduites, démontrant le pouvoir des infrastructures de paiement comme armes économiques.
4. Twitter/X et la censure géographique
Entre 2021 et 2025, plusieurs cas de suspension de comptes sur Twitter/X ont illustré l’influence des politiques américaines sur la liberté d’expression. Au Nigeria en juin 2021, le gouvernement avait suspendu Twitter après la suppression d’un tweet présidentiel. En Europe en 2025, des comptes de personnalités publiques ont été suspendus suite à des pressions diplomatiques.
Enjeu démocratique : Lorsqu’une plateforme américaine peut décider unilatéralement qui a le droit de s’exprimer, la souveraineté numérique devient indissociable de la souveraineté démocratique.
5. L’Iran privé de mises à jour Microsoft
Dès 2013, Microsoft a restreint l’accès aux mises à jour Windows en Iran en conformité avec les sanctions américaines. Ces restrictions persistent en 2025 sur Azure, affectant des institutions iraniennes, y compris des hôpitaux et des universités qui utilisaient des services cloud.
Dimension humanitaire : Les sanctions technologiques dépassent les cibles officielles. Les systèmes informatiques obsolètes deviennent des vecteurs de cyberattaques, créant des risques de sécurité pour les populations civiles.
Implications concrètes pour les entreprises européennes
Ces précédents ne concernent pas uniquement des États ou des institutions internationales. Les entreprises européennes sont directement exposées à ces risques.
Risques opérationnels immédiats
La suspension de services cloud peut paralyser les activités en quelques heures, sans sauvegarde accessible. Le blocage des paiements internationaux affecte la chaîne d’approvisionnement et les relations commerciales. La perte d’accès aux outils collaboratifs (Microsoft 365, Google Workspace) désorganise les équipes. La révocation de licences logicielles rend les systèmes critiques inutilisables.
Ces risques ne sont plus théoriques. Une entreprise européenne travaillant avec des partenaires soumis à sanctions américaines peut voir ses comptes professionnels suspendus par mesure de précaution, sans avoir elle-même enfreint aucune loi européenne.
Vulnérabilités juridiques et réglementaires
Le conflit RGPD vs CLOUD Act place les entreprises européennes dans une position intenable. Le RGPD impose la protection des données personnelles sur le territoire européen, tandis que le CLOUD Act permet aux autorités américaines d’exiger l’accès à ces mêmes données. Utiliser des services cloud américains expose à ce conflit juridique permanent.
Les sanctions extraterritoriales américaines s’appliquent aux entreprises européennes dès lors qu’elles utilisent le dollar ou des technologies américaines. Une PME française qui traite avec l’Iran via des services cloud AWS peut théoriquement être sanctionnée par les États-Unis.
Risques stratégiques et concurrentiels
La dépendance technologique limite l’autonomie stratégique des entreprises européennes. Elles ne maîtrisent ni la feuille de route des technologies qu’elles utilisent, ni les conditions tarifaires futures, ni la pérennité de leur accès.
L’espionnage industriel devient un risque structurel. Le CLOUD Act permet aux agences américaines d’accéder aux données stockées par les entreprises US. Une innovation développée sur Microsoft Azure ou AWS devient potentiellement accessible aux autorités américaines et, par extension, aux concurrents américains.
Actions concrètes pour renforcer votre souveraineté numérique
Face à ces risques, les entreprises européennes disposent de leviers d’action pour réduire leur dépendance technologique.
1. Audit de dépendance technologique
Cartographier les infrastructures critiques en identifiant tous les services cloud utilisés et leur localisation géographique, les systèmes de paiement et leur juridiction, les outils collaboratifs et leurs conditions d’accès, ainsi que les licences logicielles et leurs clauses de révocation.
Évaluer les risques selon trois critères :
- l’impact opérationnel d’une suspension (paralyse l’activité, ralentit la production, gêne mineure),
- la probabilité de suspension (exposition à des sanctions, secteur sensible, utilisation standard),
- et les alternatives disponibles (solutions européennes existantes, migration possible, dépendance totale).
2. Stratégie de diversification
Adopter une approche multi-cloud en répartissant les charges de travail entre plusieurs fournisseurs cloud, privilégiant des acteurs européens (OVHcloud, Scaleway, T-Systems), et maintenant des capacités d’infrastructure on-premise pour les données critiques.
Migrer vers des solutions de paiement européennes en utilisant la Carte Bleue plutôt que Visa/Mastercard pour les paiements domestiques, explorant des solutions comme SEPA Instant Payment pour les virements, et envisageant l’euro numérique lors de son déploiement.
3. Privilégier l’open-source et les alternatives européennes
L’open-source offre une indépendance technologique réelle. Les logiciels open-source ne peuvent être révoqués unilatéralement, leur code source est auditable pour la sécurité et la conformité, et les communautés européennes garantissent la pérennité.
Alternatives concrètes :
- Nextcloud (européen) au lieu de Google Drive ou Dropbox
- LibreOffice ou OnlyOffice au lieu de Microsoft Office
- PostgreSQL ou MariaDB au lieu de bases propriétaires
- Linux au lieu de Windows pour les serveurs
- Element/Matrix au lieu de Slack pour la messagerie d’équipe
4. Participer aux initiatives européennes
Plusieurs initiatives européennes démontrent qu’une souveraineté technologique est possible.
Galileo, le système de positionnement européen opérationnel depuis 2016, illustre une réussite majeure de souveraineté numérique. Avec 27 satellites opérationnels en 2025, Galileo offre une précision de 1 mètre contre 5 mètres pour le GPS américain en mode standard, et jusqu’à 20 centimètres avec son service haute précision gratuit. Cette performance garantit à l’Europe une indépendance stratégique pour la géolocalisation. Plus de 5,2 milliards de smartphones compatibles ont été vendus dans le monde, démontrant qu’une alternative européenne peut s’imposer face à un standard américain établi.
Eurostack, soutenu par la Fondation Bertelsmann, vise à créer une infrastructure numérique européenne souveraine. Elle propose une pile technologique complète (cloud, stockage, calcul, IA) développée et hébergée en Europe, sous gouvernance européenne respectant le RGPD nativement, et s’appuyant sur l’open-source et l’interopérabilité.
Gaia-X, l’initiative franco-allemande pour le cloud européen, définit des standards d’interopérabilité, certifie les fournisseurs cloud conformes aux valeurs européennes, et facilite la portabilité des données entre fournisseurs.
5. Former et sensibiliser les équipes
La souveraineté numérique n’est pas qu’une question technique. Elle requiert une prise de conscience collective à tous les niveaux de l’entreprise.
Programme de sensibilisation incluant des formations sur les risques de dépendance technologique, des ateliers sur les alternatives européennes disponibles, une veille sur les évolutions géopolitiques affectant les technologies, et l’intégration de critères de souveraineté dans les processus d’achat IT.
Obstacles et réalités de la transition
La réduction de la dépendance technologique américaine se heurte à plusieurs obstacles structurels qu’il convient de reconnaître.
Le déni institutionnel
Malgré les alertes répétées d’experts comme Gilles Babinet, entrepreneur et membre du Conseil National du Numérique, le déni des entreprises et administrations reste massif. Les raisons sont multiples : l’inertie organisationnelle face au changement, la sous-estimation des risques géopolitiques, la perception que “cela n’arrive qu’aux autres”, et le manque de culture de la souveraineté numérique.
L’écart d’investissement
Les géants technologiques américains investissent des sommes colossales que l’Europe peine à égaler. En 2024, Amazon, Microsoft et Google ont investi plus de 150 milliards de dollars en R&D et infrastructures. Les budgets européens équivalents restent fragmentés entre États membres, sans coordination suffisante.
L’effet de réseau
Les technologies américaines bénéficient d’effets de réseau puissants. Plus une plateforme est utilisée, plus elle devient indispensable. Migrer implique de convaincre partenaires, clients et fournisseurs de suivre, créant une inertie considérable.
Le retard technologique dans certains domaines
Dans l’intelligence artificielle et le cloud computing, l’avance américaine (et chinoise) est significative. Les alternatives européennes existent mais n’offrent pas toujours le même niveau de maturité ou de fonctionnalités.
Vers une Europe numérique souveraine
La souveraineté numérique européenne ne se construira pas sans volonté politique forte et investissements massifs.
Un “Buy European Act” numérique
Sur le modèle du Buy American Act, un Buy European Act pourrait imposer aux administrations publiques de privilégier les solutions européennes lorsqu’elles existent, à compétences techniques équivalentes. Cette préférence européenne accélérerait la maturation des acteurs locaux et créerait un marché stable pour l’innovation.
Des investissements massifs dans la recherche
L’Horizon Europe, programme de recherche européen doté de 95 milliards d’euros pour 2021-2027, doit prioriser les technologies stratégiques : cloud souverain et edge computing, intelligence artificielle européenne éthique, cryptographie post-quantique, et systèmes d’exploitation open-source.
Une coopération renforcée entre États membres
La fragmentation européenne affaiblit la capacité collective à concurrencer les géants américains. Une coordination accrue permettrait la mutualisation des investissements en R&D, l’harmonisation des réglementations pour créer un marché unique numérique réel, et le développement de champions européens par consolidation.
Apprendre des exemples chinois et russes
Face aux sanctions américaines, la Chine et la Russie ont développé leurs propres écosystèmes. La Chine dispose de HarmonyOS (alternative à Android/iOS), Baidu, Alibaba Cloud, Tencent (alternatives aux GAFAM), et UnionPay (alternative à Visa/Mastercard). La Russie a développé SPFS (alternative à SWIFT), Yandex (alternative à Google), et VKontakte (alternative à Facebook).
Ces exemples démontrent qu’il est possible de construire des alternatives viables, moyennant des investissements importants et une volonté politique durable. L’Europe dispose d’atouts majeurs : un marché de 450 millions de consommateurs, une excellence scientifique reconnue, et un cadre réglementaire (RGPD, AI Act) qui peut devenir un avantage concurrentiel.
La souveraineté numérique, enjeu stratégique du 21ème siècle
Les incidents de 2025 concernant le juge français Nicolas Guillou et les membres de la CPI ne sont que les manifestations visibles d’un problème structurel : la dépendance européenne aux infrastructures technologiques américaines constitue une vulnérabilité stratégique majeure.
Pour les entreprises européennes, cette réalité impose une révision urgente des stratégies technologiques. La souveraineté numérique n’est plus un luxe idéologique mais une nécessité opérationnelle et juridique.
Les priorités d’action :
- Auditer la dépendance technologique actuelle
- Diversifier les fournisseurs et privilégier les solutions européennes
- Adopter l’open-source pour les infrastructures critiques
- Participer aux initiatives européennes (Eurostack, Gaia-X)
- Former les équipes aux enjeux de souveraineté numérique
La transition sera longue et coûteuse. Mais le coût de l’inaction pourrait s’avérer bien plus élevé : celui de la perte d’autonomie stratégique et de la capacité à protéger ses données, ses innovations et ses valeurs.
Notions essentielles abordées
Souveraineté numérique
Définition complète, dimensions multiples et enjeux stratégiques pour l'Europe face à la dépendance technologique
Lire l'article →CLOUD Act
Législation américaine de 2018 permettant l'accès extraterritorial aux données et son conflit avec le RGPD européen
Lire l'article →Galileo
Système de positionnement européen plus précis que le GPS, exemple de réussite de souveraineté technologique
Lire l'article →SWIFT
Réseau mondial de messagerie financière sécurisée utilisé par plus de 11 000 institutions pour les transactions internationales
Eurostack
Initiative européenne visant à créer une pile technologique souveraine (cloud, stockage, IA) développée et hébergée en Europe
Gaia-X
Projet franco-allemand de cloud européen fédéré établissant des standards d'interopérabilité et de souveraineté des données
Extraterritorialité juridique
Application d'une législation nationale au-delà des frontières de l'État qui l'a édictée
Effet de réseau
Phénomène économique où la valeur d'un service augmente avec le nombre d'utilisateurs
Open-source
Modèle de développement logiciel où le code source est public et librement modifiable
📚 Sources et références ▼
Incidents 2025 documentés
Cas historiques
Menaces contre la CPI
Initiatives européennes
Pour aller plus loin
Souveraineté numérique : définition, enjeux et stratégies pour l'Europe
Comprendre la souveraineté numérique, ses enjeux stratégiques pour l'Europe, et les initiatives pour réduire la dépendance aux géants technologiques américains.
Lire l'article → Concepts & NotionsGalileo : le système de positionnement européen et enjeu de souveraineté
Découvrez Galileo, le système de navigation par satellite européen plus précis que le GPS américain, et son rôle dans la souveraineté numérique européenne.
Lire l'article → Concepts & NotionsCLOUD Act : législation américaine sur l'accès extraterritorial aux données
Comprendre le CLOUD Act américain de 2018, son conflit avec le RGPD européen et ses implications pour les entreprises utilisant des services cloud US.
Lire l'article → Gouvernance des donnéesRGPD assoupli en 2025 : l'Europe cède-t-elle aux géants de l'IA ?
La Commission européenne assouplit le RGPD et l'AI Act en novembre 2025 : analyse des changements majeurs, entre pragmatisme économique et recul des droits numériques.
Lire l'article →